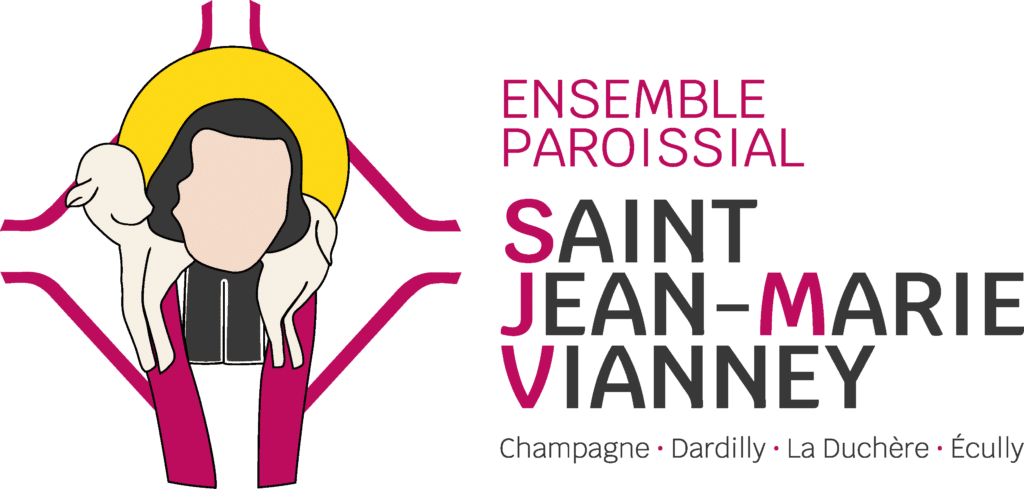Chers frères et sœurs,
Jésus n’aurait-il pas oublié un petit quelque chose ? J’imagine aisément l’assistance suspendue à ses lèvres, et qui, à la fin de cette parabole surprenante, s’interroge et réclame la suite : « Et, à la fin, que s’est-il passé ? » Dans la dernière scène, le fils aîné, furieux, est sur le perron de la maison, refusant d’entrer, et son père le supplie. Ses arguments suffiront-ils à le convaincre ? La brouille entre les deux frères sera-t-elle définitive ? Cela n’est pas dit, cela n’est pas écrit. Pourtant, plutôt que de considérer ce qui manque à cette parabole inachevée, nous pourrions écouter ce sur quoi elle débouche : non pas la morale de l’histoire, mais le silence. Un vrai silence de carême ! Un silence semblable à celui du diable qui se tait, à cours de tentations, à la fin de l’évangile du premier dimanche du carême. Un silence semblable à celui que le prophète Élie a perçu sur la montagne de l’Horeb, et dont il témoigne à Jésus au moment de sa Transfiguration, dans l’évangile du deuxième dimanche du carême. Un silence semblable à celui de Jésus qui n’explique pas, par une belle théorie, le mystère du mal, dans l’évangile du troisième dimanche du carême. Encore et toujours le silence ! Et ce silence n’est peut-être pas, comme on le croit trop souvent, du rien, du vide, du manque. Sacha Guitry disait que « lorsqu’on vient d’entendre un morceau de Mozart, le silence qui lui succède est encore de lui. » Cette phrase s’applique tout autant à Jésus : le silence qui suit la parabole, c’est encore du Jésus, et ce silence au sujet du père et de ses deux fils, loin de nous en éloigner, nous ramène au cœur de la parabole. « Un père avait deux fils. » Jésus nous prévient dès le début : cette histoire n’est donc pas seulement celle du plus jeune, le « prodigue », le dépensier, le flambeur. Pourtant, bien souvent nous résumons la parabole au départ, à la conversion et au retour de cet enfant à qui son père pardonne ses égarements. Et tout pourrait s’achever sur un happy end, une magnifique réconciliation. Il serait donc juste de ne pas oublier le frère aîné. Nous ne pensons pas à lui pour une raison : c’est un taiseux. Il est silencieux, mais il n’en pense pas moins. Il se tait devant le départ de son frère, parce qu’il sait qu’il est dans son bon droit : le cadet est un ingrat, mais lui, l’aîné, c’est le bon fils, celui qui est fidèle et qui fait tout bien. Il se tait aussi devant son père parce qu’il ne veut pas réclamer, c’est malpoli : il sait qu’un jour, il sera récompensé. Il aura sa part d’héritage. En attendant, il voudrait bien un chevreau à rôtir, pour s’amuser, juste un peu, avec ses amis qui sont sages et bien élevés comme lui. Mais son père n’y pense même pas. Le fils aîné est comme un vase qui se remplit de frustration, goutte après goutte, et la fête en l’honneur du petit frère rentré à la maison est la goutte qui fait tout déborder : et la colère du grand frère est à la mesure de tout ce qu’il s’est retenu de faire et de dire, au long de toutes ces années. Il y a donc deux silences. L’un est le silence de souffrance intériorisée du fils aîné, qu’il faut prendre au sérieux : il n’est pas le méchant de la parabole, celui qui par calcul refuserait de pardonner au petit frère, mais il est lui aussi un fils blessé, qui cherche la gratitude dont nous avons tous besoin pour vivre. Et il y a le second silence, celui de Jésus qui laisse ouverte la fin de la parabole. Ce silence-là est synonyme de liberté, car la miséricorde ne se commande pas. Le père de la parabole est comme saint Paul dans l’épître aux Corinthiens ; il ne peut pas exiger le pardon, ce qui serait une violence il ne peut que le mendier : « Nous vous en supplions, au nom du Christ : laissez-vous réconcilier avec Dieu ! » Libre aux Corinthiens, libre au fils aîné, de recevoir ou non cet appel à accepter le pardon qui leur est offert. Il arrive qu’entre le moment où un pardon est donné par une personne et le moment où il est accepté par une autre, des jours, des mois, des années se passent. Tant pis, tant mieux. Le pardon vient toujours à son heure. Au début de l’évangile, saint Luc précise que ce n’est pas pour son auditoire habituel – les disciples et la foule – que Jésus raconte les paraboles des retrouvailles : la brebis perdue, la pièce d’argent égarée, le fils prodigue. Jésus les raconte pour les scribes et les pharisiens qui, comme nous sans doute le ferions à leur place, sont choqués des mauvaises fréquentations de ce drôle de prophète, qui ne semble pas assez sévère avec les pécheurs, et qui, à leur table, pourrait presque passer pour leur complice. Ces scribes et ces pharisiens qui ne sont pas des méchants, mais qui ressemblent tellement au fils aîné. Jésus veut leur faire toucher du doigt combien il faut de temps et de silence pour qu’un homme accepte librement de se laisser aimer, et de changer de vie. Pour laisser cette transformation s’opérer, la patience et la pudeur sont indispensables. Peut-être, dans la nuit, le père et son fils ont-ils longuement continué à parler, à se demander pardon, à se retrouver, à ressusciter. Nous ne saurons jamais ce qu’ils se sont dits, nous ne connaîtrons jamais la conclusion de cette histoire sans fin, et c’est tant pis, et c’est tant mieux. Car Dieu nous aime ; et le reste est silence. Amen.