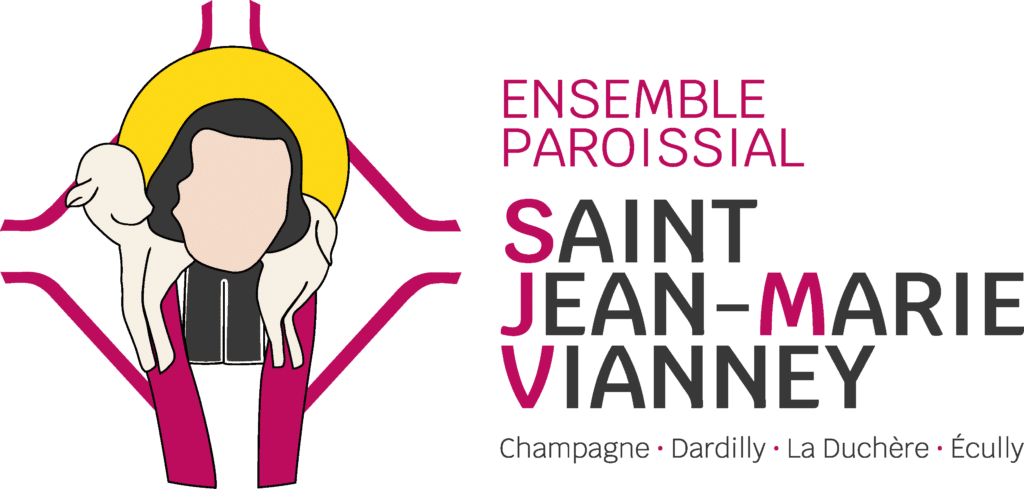Chers frères et sœurs,
Je me fais rarement gronder à la sortie d’une messe, mais quand cela m’arrive, je m’en souviens. Il y a quelques années, un dimanche des Rameaux, je m’étais risqué à dire que les Chrétiens sont tous des ânes, puisqu’ils ont le privilège de porter le Christ sur leurs épaules. À la sortie de la messe, une paroissienne, outrée, avait foncé sur moi et m’avait vertement reproché de l’avoir insultée. Si j’ose dire : furieuse de s’être faite traiter d’ânesse, elle était montée sur ses grands chevaux.
Il y a deux-mille-cinq-cents ans déjà, le prophète Zacharie utilisait précisément cette distinction, parmi les équidés, entre le cheval et l’âne, pour mieux la renverser : « Fille de Jérusalem, (…) voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse. Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat. » Tel David devant le géant Goliath, l’envoyé de Dieu choisit pour monture et pour symbole le petit âne insignifiant, sans défense, dont la force paisible l’emporte sur la splendeur des chevaux. Je ne sais pas comment, à l’époque, l’auditoire de Zacharie avait réagi, mais je ne suis pas certain que cette image du roi monté sur un âne ait été bien comprise. Un cheval, c’est chic ; un âne, c’est ridicule…
Au cours de l’été 1878, un jeune écrivain écossais établi à Paris, Robert Louis Stevenson, tombe éperdument amoureux d’une belle Américaine. Mais la relation est de courte durée, et la rupture plonge Stevenson dans un profond état dépressif. Pour oublier sa tristesse, il décide de partir à l’aventure, à pied, à travers le massif des Cévennes, depuis le Monastier, en Haute-Loire, jusqu’à Alès, dans le Gard. De ce périple, il tirera un livre intitulé Voyage avec un âne dans les Cévennes. De fait, dès le départ, se pose la question du transport de ses effets personnels, trop lourds pour qu’il les porte lui-même. « Restait, écrit-il, à choisir une bête de somme. Or, un cheval est, d’entre les animaux, comme une jolie femme, capricieux, peureux, difficile sur la nourriture et de santé fragile. (…) Un chemin difficultueux affole le cheval, bref c’est un allié exigeant et incertain qui ajoute cent complications aux embarras du voyageur. Ce qu’il me fallait, c’était un être peu coûteux, point encombrant, endurci, d’un tempérament calme et placide. Toutes ces conditions requises désignaient un baudet. » Ainsi Stevenson, le jour de son départ – le 22 septembre 1878 – avise-t-il un vieil homme, qui possède « une chétive ânesse, pas beaucoup plus grosse qu’un chien, de la couleur d’une souris, avec un regard plein de bonté ». Il l’achète aussitôt, « pour soixante-cinq francs et un verre d’eau-de-vie », et la prénomme Modestine. C’est avec elle pour seule compagnie qu’il va traverser, non seulement le massif des Cévennes, mais aussi sa crise intérieure.
Avec humour, Stevenson décrit à plusieurs reprises l’opiniâtreté de Modestine. Elle obéit difficilement, elle rechigne, elle est têtue, mais ce trait de son caractère la rend aussi endurante et attachante, amie fidèle autant que muette – sauf quand elle se met « à braire très fort d’une voix enrouée, comme un coq annonçant la naissance de l’aurore. » De fait, elle annonce pour Stevenson une aurore, une seconde chance, une consolation, en un mot, une espérance. Arrivé au bout du chemin, le regard de Stevenson sur Modestine a changé, et il se sépare d’elle à contre-cœur : « Pendant douze jours nous avions été d’inséparables compagnons. (…) Après le premier jour, quoique je fusse souvent choqué et hautain dans mes façons, j’avais cessé de m’énerver. Pour elle, la pauvre âme, elle en était venue à me considérer comme une providence. Elle aimait manger dans ma main. Elle était patiente, élégante de formes et couleur d’une souris idéale, inimitablement menue. Ses défauts étaient ceux de sa race et de son sexe ; ses qualités lui étaient propres. Adieu, et si jamais… »
Modestine, voilà le beau nom d’un vrai tout-petit à la manière de l’évangile. Stevenson, le sage, le savant, l’érudit, l’indépendant, l’homme libre et fier de l’être, est passé de la condescendance pour elle à l’amitié. Il l’avait choisie pour être une bête de somme, et elle est devenue pour lui une source de repos véritable, de retour à la joie, de découverte de la paix. « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Les mots de Jésus évoquent un repos paradoxal, que l’on reçoit en se revêtant d’un joug, d’un fardeau qui soulève celui qui le porte, au lieu de l’écraser. Il faut avoir voyagé pour saisir la force des paradoxes. Modestine, à défaut de joug, portait un bât, à l’installation duquel Stevenson consacre plusieurs pages : le bât, c’est cette selle qui permet de porter des bagages, et qui doit être installé avec délicatesse sur l’animal, sans quoi, selon l’expression consacrée, « le bât blesse ».
Chers frères et sœurs, je me risque à le redire : nous sommes des ânes, nous sommes même des ânes bâtés. Voilà le bel idéal de la vie chrétienne : plutôt que le cheval qui s’élance sur l’hippodrome, désirons être cette bête de somme à qui le Seigneur, par un harnachement ajusté avec tant d’amour, nous permet de porter ses propres affaires, son œuvre, sa mission. Et si tantôt nous sommes comme Modestine, un peu râleurs, un peu rétifs, un peu lents, sachons que Dieu nous regarde avec une tendresse que nous n’imaginons pas. Il nous fait confiance plus que nous n’oserions le demander. Alors, avec joie, répétez après moi : Je suis un âne bâté !
Amen.