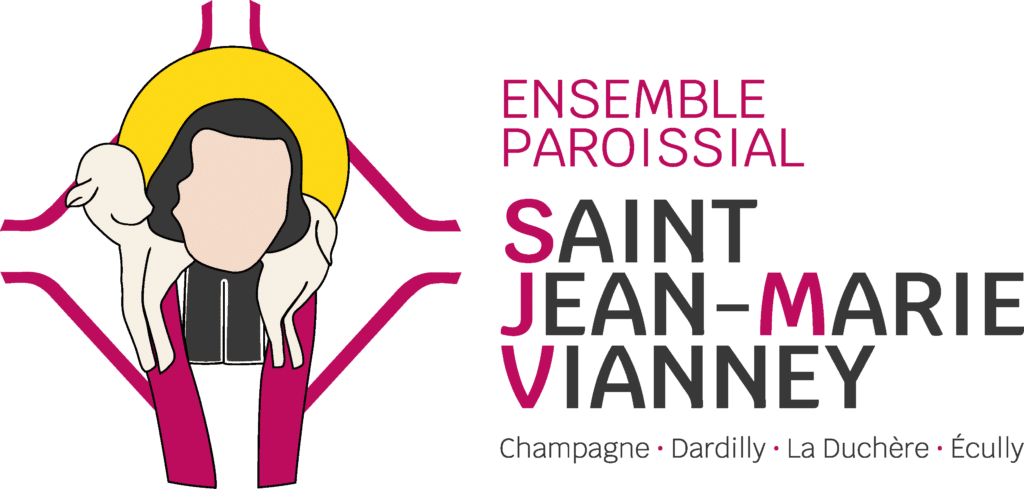« Que c’est petit, un village ! Et ce village était ma paroisse. (…) Il avait l’air de s’être couché là, dans l’herbe ruisselante, comme une pauvre bête épuisée. (…) Je pensais à ces bestiaux que j’entendais tousser dans le brouillard et que le petit vacher, revenant de l’école, son cartable sous le bras, mènerait tout à l’heure à travers les pâtures trempées, vers l’étable chaude, odorante… Et lui, le village, il semblait attendre aussi – sans grand espoir – après tant d’autres nuits passées dans la boue, un maître à suivre vers quelque improbable, quelque inimaginable asile. »
Chers frères et sœurs,
C’est par ces mots que commence le Journal d’un curé de campagne, le grand roman de Georges Bernanos, publié en 1936. Le personnage principal, nommé curé d’Ambricourt, dans le Pas-de-Calais, découvre sa petite paroisse, et Bernanos s’est inspiré explicitement de saint Jean-Marie Vianney qui, contemplant Ars dans la brume du 9 février 1818, depuis le Monument de la Rencontre, avait lui-même songé : « Que c’est petit ! » N’y voyez aucune condescendance, chers habitants d’Ars, ni non plus l’expression d’une déception, mais plutôt celle d’une profonde tendresse, telle que l’on peut en ressentir lorsque l’on devient pour la première fois père, ou mère, ou curé : ce petit être lui était confié, il en devenait le pasteur, et il faudrait qu’il prenne soin de cette paroisse, comme du petit troupeau de moutons que jadis, enfant, à Dardilly, il menait paître dans le Vallon de Chantemerle. L’attitude si humble du petit prêtre devenu desservant du petit village d’Ars semble contraster énormément avec les paroles par lesquelles saint Paul, dans la deuxième lecture, d’adresse aux Corinthiens : « Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ. » Cette formule semble bien péremptoire, présomptueuse. Qui parmi nous oserait réclamer d’être imité, sinon un vantard, un narcissique, un orgueilleux, bref précisément quelqu’un qu’il vaudrait mieux s’abstenir d’imiter ? Pourtant, c’est bien une recommandation pleine de sagesse que saint Paul fait à ces enfants terribles que sont les Chrétiens de la petite Église de Corinthe. Il leur rappelle simplement que l’art commence par l’imitation. Le pianiste qui rêve d’être un nouveau Chopin commence par faire ses gammes ; le peintre qui rêve d’être un nouveau Rembrandt commence par recopier les œuvres des anciens. Et celui qui cherche la sagesse commence par se mettre à l’école d’un maître. Cela suppose que, pour qu’il y ait de l’imitation d’un côté, il y ait de l’autre côté un exemple stimulant, attirant. Douze ans auparavant, grand adolescent désireux d’entrer au séminaire, saint Jean-Marie Vianney s’était mis à l’école de Monsieur Balley, le curé d’Écully, qui avait eu l’intuition de reconnaître chez cet élève peu sûr de lui et médiocre en latin ce qu’il fallait pour faire un bon prêtre. Devenu curé d’Ars, il a tâché de susciter chez ses paroissiens le même désir d’imiter sa proximité avec Dieu. L’imitation n’est pas déjà la perfection, mais un chemin qui s’ouvre. Aussi, « Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ » n’est pas une parole de gourou, mais une parole de disciple. La vie chrétienne se fonde sur l’émulation et sur la capillarité : les disciples deviennent des maîtres et transmettent à leur tour ce qu’ils ont reçu à de nouveau disciples, et, de la sorte, l’Église grandit et se multiplie. Cela aussi, saint Jean-Marie Vianney le savait, ou le sentait, ce 9 février 1818. Après s’être dit : « Que c’est petit ! », une autre pensée, plus étonnante, lui vint : « Cette paroisse ne pourra contenir tous ceux qui plus tard y viendront. » C’était, dira-t-il pour s’en excuser, une idée un peu « baroque » ! Mais, de fait, cette pensée était prémonitoire. Dans l’évangile selon saint Marc dont nous faisons la lecture cursive du premier chapitre depuis un mois, nous voyons comment en Jésus il y a une autorité et une bonté qui attirent irrésistiblement ceux dont il croise la route. C’est successivement le cas des premiers disciples, Pierre et André, Jacques et Jean, puis des habitants de Capharnaüm, puis de toute la Galilée, et l’évangile de ce dimanche se termine par l’image d’un véritable raz-de-marée humain : « De partout cependant on venait à lui. » Pourquoi tant de monde ? Parce que la parole de Jésus vient rencontrer une attente profondément enracinée dans le cœur de l’homme, un « vide en forme de Dieu », comme le dit Blaise Pascal. De cette attente, le récit de la rencontre de Jésus avec ce lépreux est le symbole. Il voit venir à lui un homme dont la vie est en mille morceaux – à la fois au sens propre, parce que sa chair se décompose petit à petit, et au sens figuré, parce qu’il est frappé d’exclusion, afin qu’il ne contamine personne par son impureté. La pandémie de Covid que nous traversons nous donne une toute petite idée de l’audace dont Jésus fait preuve : il n’éprouve pour cet homme ni dégoût, ni rejet, et il fait le choix délibéré de ne pas le guérir à distance, « sans contact ». Jésus est de ce fait peut-être la première personne qui ose le toucher depuis des années. Et c’est de cette manière qu’il atteste que c’est la grâce qui est contagieuse, infiniment plus que toute espèce de mal. Chers frères et sœurs, le lépreux de l’évangile est une image de ce qu’était la petite paroisse d’Ars en février 1818, il est aussi une image de ce que peut être notre Eglise en bien des lieux, à l’écart, ses membres abîmés par le mal, par le péché, incertaine de son avenir, osant à peine prononcer ces mots : « Si tu le veux, tu peux me purifier »… Alors, notre espérance grandit en regardant comment saint Jean-Marie Vianney a rebâti sa paroisse en y provoquant une pandémie de miséricorde, et c’est aussi ce que nous célébrons ce matin. C’est bien cela, une paroisse : un lieu où des pécheurs pardonnés ont une joie contagieuse, si bien qu’elle donne à d’autres pécheurs l’envie de les imiter. Une paroisse, que c’est petit… et que c’est grand !Amen.