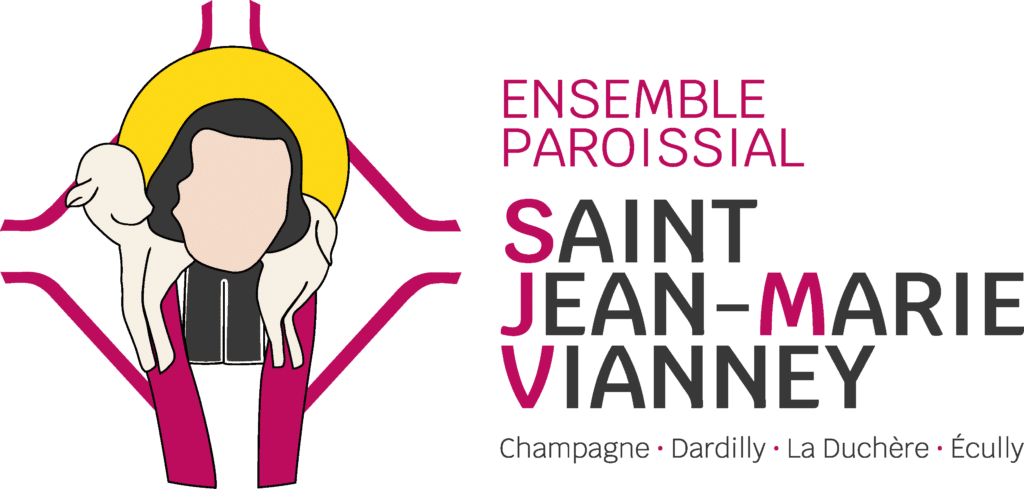Chers frères et sœurs,
Vous êtes-vous déjà demandés ce qui faisait pleurer les saules pleureurs ? C’est peut-être une question étrange, mais j’assume me l’être longtemps posée : ces grands arbres que l’on trouve au bord des rivières où penche leur ramure, comme la longue chevelure d’une femme à la tête baissée, ont-ils vraiment de bonnes raisons de pleurer ?
Il m’a fallu un certain temps pour faire le lien entre les saules pleureurs et le début du psaume 136 que la liturgie nous donne d’entendre ce dimanche : « Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion ; aux saules des alentours, nous avions pendu nos harpes. » Et le nom savant du saule pleureur, c’est… salix babylonica, le « saule de Babylone ». Si le saule pleureur continue de pleurer, c’est qu’aujourd’hui encore il rappelle l’immense peine que le peuple d’Israël a pu ressentir il y a deux mille sept cents ans à la suite de cette tragédie qui a vu le roi Nabuchodonosor prendre la ville de Jérusalem, en détruire le Temple et en déporter les habitants à Babylone.
Le saule pleureur, depuis ce jour-là, est devenu un symbole universel de mélancolie. Il confère aux jardins un charme romantique et il porte à se languir sur fond d’automne triste. Il accompagne les rêveries de ceux qui marchent les yeux fixés sur leurs pensées, ou qui pleurent la perte des paradis parfumés. Le début du psaume est plein de cette mélancolie : les Juifs en exil se souviennent de Jérusalem avec une infinie tristesse et se plaignent de devoir chanter des musiques de chez eux alors que leur pays leur a été arraché. C’est insupportable pour eux. On dirait aujourd’hui : ils ont le blues. Ils veulent se battre pour ne pas oublier qui ils sont et d’où ils viennent, dans ce pays étranger où ils sont prisonniers.
Pourtant, le psaume se termine sur un serment : « Je veux que ma langue se colle à mon palais si je perds ton souvenir, si je n’élève Jérusalem au sommet de ma joie ! » Cela peut sembler paradoxal : l’instant d’avant, le psalmiste refusait de chanter aux Babyloniens des « airs joyeux » de son pays, et à présent le voilà qui parle d’« élever Jérusalem au sommet de sa joie »… C’est que sous le même mot il est question de deux joies bien différentes. L’exilé refuse la petite joie mensongère ce celui qui fait semblant d’aller bien, mais il veut faire grandir en lui une autre joie, celle de l’espérance. Autrement dit, la petite joie insouciante, c’est non ! Mais la grande joie exigeante, alors oui !
La vraie joie, c’est donc un « sommet » vers lequel il faut grimper. Un sommet, comme la ville de Jérusalem, construite sur une montagne, et vers laquelle on est obligé de monter. Un sommet comme le serpent de bronze que Dieu fait faire à Moïse dans le désert : ceux qui ont été mordus par les serpents venimeux et qui se retrouvent étendus par terre doivent lever le regard vers ce talisman pour ne pas mourir. Un sommet comme la croix, enfin, surélevée par-rapport à la foule du Golgotha qui regarde celui qu’elle a transpercé : « Ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Chacun des textes de ce dimanche est un chemin escarpé qui monte de la mélancolie à l’espérance, et qui aboutit à une joie paradoxale et bouleversante.
La semaine dernière, pour la première fois dans l’histoire, un Pape s’est rendu lui-même au bord des fleuves de Babylone, dans ce pays qui aujourd’hui se nomme l’Irak. Dimanche dernier, dans l’église de Qaraqosh, au cœur du la plaine de Ninive dévastée et martyrisée par les islamistes, le Pape a encouragé en ces termes la petite communauté catholique :
« Avec grande tristesse, nous regardons tout autour et nous voyons (…) des signes du pouvoir destructeur de la violence, de la haine et de la guerre. Que de choses ont été détruites ! Et combien doivent être reconstruites. Notre rencontre montre que le terrorisme et la mort n’ont jamais le dernier mot. Le dernier mot appartient à Dieu et à son Fils, vainqueur du péché et de la mort. Même au milieu des dévastations du terrorisme et de la guerre, nous pouvons voir, avec les yeux de la foi, le triomphe de la vie sur la mort. (…) Le moment est venu de reconstruire et de recommencer, en se confiant à la grâce de Dieu qui guide le destin de tout homme et de tous les peuples. »
Chers frères et sœurs, ne nous contentons pas dans notre vie chrétienne d’une joie médiocre, d’une joie tranquille, pépère et facile. Laissons-nous surprendre par la joie que le Seigneur nous révèle dans l’adversité et qui nous fait relever la tête et nous donner l’énergie de monter vers une rencontre au sommet. Même les saules pleureurs ont de bonnes raisons de sécher leurs larmes et de relever la tête : il est temps de décrocher nos harpes de leurs branches, pour que notre prière ce matin soit déjà, par avance, une hymne à la joie de Pâques.
Amen.