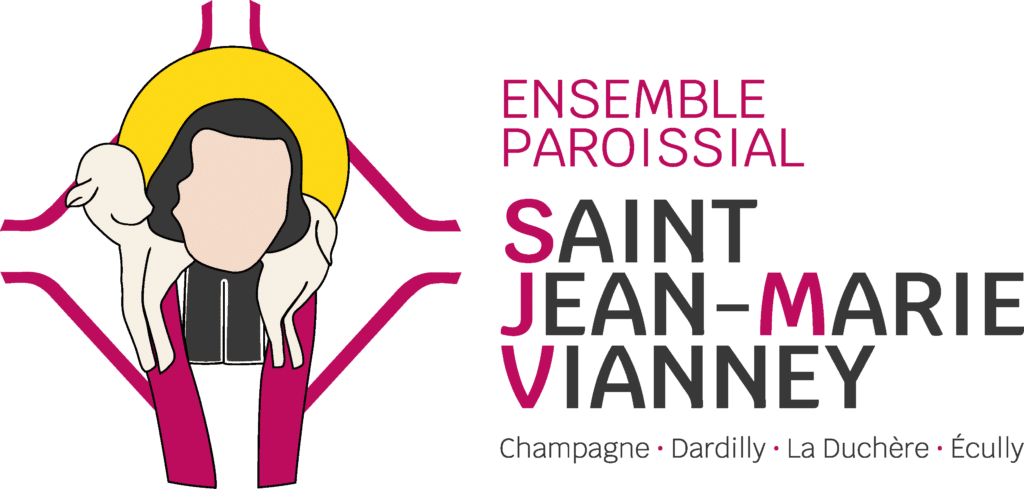Chers frères et sœurs,
Les impôts sont-ils du racket ? Il y a trente-six ans, sur le plateau de l’émission Sept sur Sept, la question avait été posée au chanteur Serge Gainsbourg. Celui-ci avait répondu : « Le racket des impôts, je vais vous dire ce que c’est. Ça, ce n’est pas une parabole, c’est du physique ! » Et, joignant le geste à la parole, il avait sorti de sa poche un billet de cinq cent francs, à l’effigie de Blaise Pascal, et y avait mis le feu. Scandale et émotion, cette image a marqué les esprits au point que je peux vous en parler encore aujourd’hui.
Les impôts sont-ils du racket ? La question ne date pas d’hier. Et la manière dont elle est posée à Jésus n’est pas anodine. Saint Matthieu, au début de l’évangile que nous venons d’entendre, consacre un temps spécialement long à décrire la mécanique du piège que les Pharisiens ont concocté contre Jésus : il nous montre successivement le complot, puis la flatterie obséquieuse, enfin la question sans issue. Et l’évangile dénonce ce processus par deux mots, ceux de « perversité » et d’« hypocrisie ».
Le piège des Pharisiens est un processus pervers : il vise sciemment à faire le mal et à détruire Jésus pour de bon. Et c’est un processus hypocrite, malhonnête. Il s’agit là, Jésus le répète dans l’évangile, de la pire caractéristique des Pharisiens : ils sont incohérents, ils sont faux, ils ne disent pas ce qu’ils pensent, et ils ne pensent pas ce qu’ils disent. « Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? » La question contient seulement deux options de réponse : oui ou non. Ce que les Pharisiens désirent, en posant la question de manière aussi sensible, aussi clivante, devant tout le monde, c’est de pousser Jésus soit vers l’hypocrisie, soit vers la mort. Soit, comme eux, il dira qu’il faut payer l’impôt à l’occupant romain, et il se discréditera aux yeux des indépendantistes juifs ; soit il dénoncera l’impôt dû à César, et le gouverneur le fera arrêter pour rébellion. D’une manière ou d’une autre il sera pris en défaut. Et ses adversaires diront : bon débarras !
« Il n’y a que deux options possibles », disent les Pharisiens à Jésus. Celui-ci se retrouve entre le marteau et l’enclume. Et sa situation ne nous semble peut-être pas étrangère… Catholiques dans l’Occident de la post-modernité, et plus encore dans l’état de profonde crise de société que connaît notre pays, nous pouvons avoir souvent le sentiment d’être nous-mêmes confrontés à une certaine forme d’intimidation, drapée tantôt dans les atours de la flatterie, tantôt dans ceux de la menace : Il n’y a que deux options possibles, nous dit-on. Choisissez donc entre le libéralisme sans entrave et l’obscurantisme aveugle ! Choisissez entre le « droit au blasphème » et le statut d’ennemis de la République ! Choisissez entre la soumission et le séparatisme ! Quand la question est posée en ces termes, nous demeurons circonspects : aucune solution ne nous semble réellement juste. Et nous sommes déchirés entre l’hypocrisie polie et la posture de l’éternel râleur.
Je ne crois pas que cet évangile, contrairement à ce que l’on entend si souvent dire, soit le socle de la « Sainte Laïcité », qui consacrerait à jamais la Séparation absolue du spirituel et du temporel. En régime chrétien, spirituel et temporel sont distincts, mais sont aussi liés : cela s’appelle l’Incarnation. Aussi il me semble que cet évangile dit aux disciples du Christ qu’ils ne sont jamais tenus de ne choisir qu’entre le marteau et l’enclume ; que le Chrétien n’est ni celui qui se soumet aveuglément au pouvoir en place, ni celui qui le combat systématiquement ; et qu’une troisième voie est non seulement possible, mais nécessaire.
La troisième voie qu’ouvre le Christ est celle de la liberté vis-à-vis de ceux qui parlent le plus fort. J’imagine que Jésus n’a pas eu besoin d’élever la voix pour demander à voir une pièce de monnaie, puis pour s’enquérir de celui qu’elle représentait. J’en reviens donc à Serge Gainsbourg et à son billet de cinq cent francs brûlé en direct, avec un sens consommé de la provocation. Un des grands principes internationaux de la monnaie est qu’elle n’appartient pas à ses utilisateurs, mais à l’autorité qui « frappe monnaie ». Ainsi, Serge Gainsbourg, par son geste, se met dans l’illégalité, puisqu’il détruit un bien qui ne lui appartient pas. Cela étant, le billet à l’effigie de Blaise Pascal, d’un montant considérable à l’époque, ne vaut plus rien aujourd’hui, vingt ans après le passage à l’euro. La monnaie n’a pas de valeur en soi, elle n’a que la valeur que César lui accorde. La monnaie vient de César et par nature elle retourne à César : elle ne fait que passer par nos mains.
A l’époque, l’affaire du billet brûlé avait fait scandale. C’était, dans ces années quatre-vingt quelque peu bling-bling, une sorte de blasphème : un outrage à la puissance sacrée de l’argent. Non : s’il y a bien un blasphème, c’est d’assassiner au nom de Dieu, en lui faisant porter le chapeau. Un meurtre est un blasphème incomparablement pire qu’une caricature. Le Dieu de Jésus-Christ n’est pas un commanditaire d’assassinats, mais il est celui qui nous a modelé à son effigie et à son inscription. Contrairement à l’argent, nous ne dévaluons jamais, notre dignité ne nous est jamais retirée, puisque notre nom est inscrit, non pas sur une pièce, mais sur Son cœur, dans les cieux. Pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu, vivons selon la loi de la vérité qui libère. Au nom de Celui qui nous a donné son propre visage, « à vous, la grâce et la paix » !
Amen.